La mort au quotidien : entretien avec le médecin légiste belge Philippe Boxho
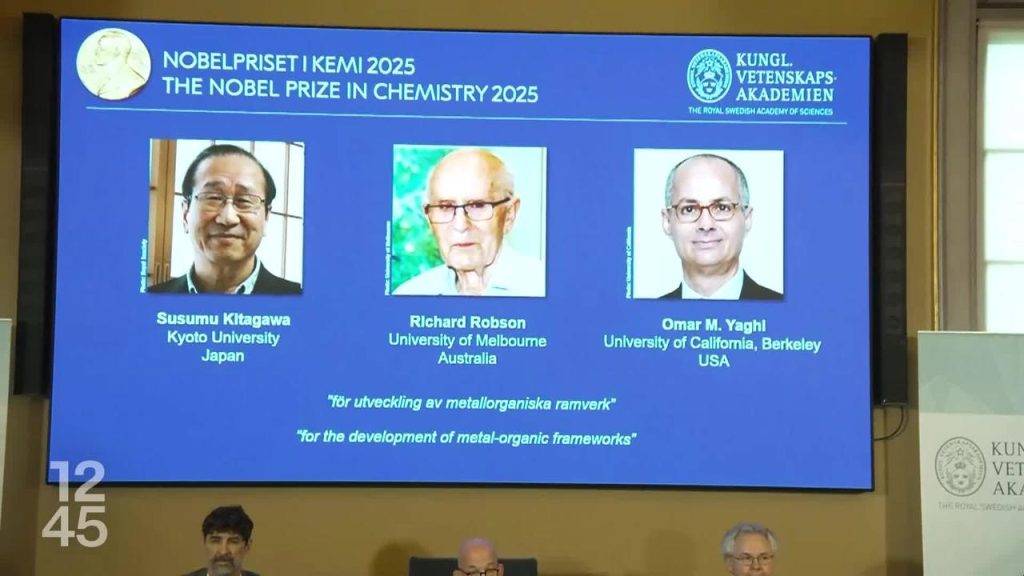
La mort au cœur de sa carrière
La mort, c’est sa vie. Cette expression a servi de titre à son quatrième best-seller, publié le 27 août, dédié aux dossiers les plus insolites de sa pratique.
Fort de plus de 3000 autopsies, le médecin légiste belge propose au public des récits tirés de son expérience et sera en dédicace le 15 octobre à la Fnac Rive de Genève (sur inscription ici).
Évolution du regard sur la mort après plus de trois décennies de pratique
Avec plus de trente ans de médecine légale derrière lui, il affirme s’être habitué à la mort, car il y est confronté au quotidien. Il précise toutefois qu’il faut rester en paix avec cette réalité et accepter que chacun mourra un jour, sans nécessairement redouter ce moment.
La peur de la mort et la question de la manière de mourir
Comme tout le monde, il a d’abord craqué pour la mort. En vieillissant, il affirme ne plus la craindre, mais redoute désormais la manière dont il pourrait mourir et préfère une fin sans souffrance. Il ajoute qu’il existe chez certains l’idée d’une « belle mort », dont chacun peut avoir une perception différente.
Le débat sur la « belle mort » et l’expérience de mourir
Pour lui, la notion de belle mort dépend des personnes: certains la vivent dans le calme, d’autres sans douleur. Il se montre toutefois curieux de l’expérience d’être conscient alors que l’on s’éteint, tout en reconnaissant que les avancées médicales repoussent sans cesse l’échéance et posent la question du droit de mourir dans notre condition humaine.
Progrès médicaux, finitude et droit de mourir
Selon lui, non seulement le droit de mourir existe, mais il est nécessaire, inscrit dans nos gènes. Né en 1965, il rappelle que l’espérance de vie a évolué grâce à la médecine, mais pense que le cerveau n’est pas conçu pour vivre 200 ans, d’où l’importance de respecter une finitude naturelle.
Foi, vocation et parcours personnel
Plus jeune, il envisageait d’entrer dans les ordres. Face aux horreurs qu’il côtoie, il affirme ne jamais regretter d’avoir renoncé et précise que le monde n’est pas nécessairement abominable; les cas qu’il raconte restent exceptionnels.
Foi et convictions personnelles
Il se définit athée, incapable de croire en Dieu, sans nier son existence potentielle. À l’époque, un évêque lui aurait appris que la foi véritable est une foi du cœur, une idée qu’il n’a pas adoptée.
Popularité des ouvrages et perception de la mort
Ses best-sellers suscitent l’intérêt pour la mort et il se demande pourquoi ce sujet attire autant l’attention des gens. Il pense que ses livres peuvent contribuer à démystifier la mort sans la sacraliser. Des psychologues lui ont confié lire ses œuvres avec leurs patients qui redoutent de mourir, ce qui leur offre une pause pour rire un peu.
Mémoire et sources d’inspiration
Pour retrouver les histoires qu’il raconte, il faut souvent revenir à ses dossiers. Il évoque des cas tels qu’un homme frappé par une stalactite, une explosion dans le crâne après deux coups de feu, ou une pendaison ratée suivie d’une fracture mortelle; pour lui, ces images restent banales et ne s’ancrent pas durablement dans sa mémoire. Rien ne l’obsède.
Leçons tirées de la mort
En conclusion, il affirme que la mort lui a appris une chose essentielle: il faut profiter de la vie et en tirer le meilleur.



